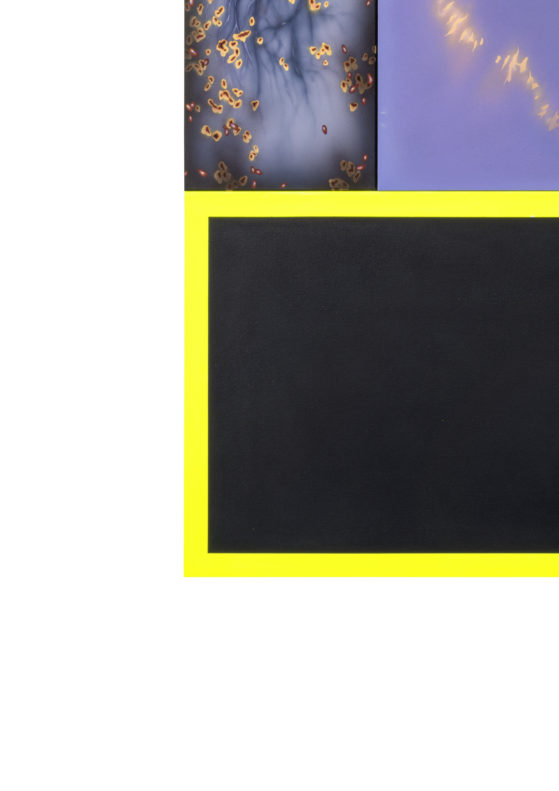
Dans ce cahier, nous vous proposons de plonger dans différents Regards, portés par des expert.e.s, artistes et autres penseur.euse.s. À l’invitation de la Fondation Leenaards, ils et elles offrent leurs réflexions personnelles et inspirantes sur des sujets liés aux domaines d’action de la Fondation.
L’objectif du projet Locali, une initiative d’APRÈS-GE soutenue par la Fondation Leenaards, est de contribuer au passage d’une économie globale et linéaire à une économie locale et circulaire. Pour cela, il vise à proposer aux Genevois.e.s différents types d’abonnements à des produits et à des services :
– des aliments locaux et de saison à choisir dans un réseau
de fermes, d’épiceries et de restaurants agréés;
– une bibliothèque de partage d’objets;
– une vêtithèque qui fonctionne comme un troc mutualisé à
l’échelle de la communauté de ses membres ;
– une centrale de mobilité qui propose des vélos (-cargos)
et des voitures en partage, et propose un accès facilité aux
transports publics et à un espace de coworking de quartier.
Cette démarche est fondée notamment sur
les résultats d’une étude
qu’APRÈS-GE a menée en 2023 sur mandat du Département
genevois de l’économie et de l’emploi (DEE), avec
l’expertise d’économistes et de la Haute école de gestion
(HEG). Elle estime que la souscription à ces abonnements
permettrait de réduire fortement l’empreinte carbone moyenne
par habitant.e, tout en créant de nombreux emplois sur le
territoire. Cette étude a également évalué l’offre et la
demande pour ces quatre produits et services dans deux
quartiers : la Jonction-Plainpalais, à Genève, et
Prulay-Champs-Fréchets-Les Vergers, à Meyrin.
L’étude a ainsi répertorié les entreprises et commerces
présents dans ces quartiers. Sur les 144 structures
identifiées, seules cinq ont une activité incompatible avec
l’objectif de Locali, tandis que la grande majorité – 108 –
sont des entreprises « à embarquer », qui pourraient
intégrer Locali si elles modifiaient leur modèle d’affaires
ou leur offre. Des interviews menées auprès d’une vingtaine
de ces commerces révèlent un grand intérêt pour la démarche,
mais aussi beaucoup de craintes quant aux efforts à fournir
pour y parvenir ou en lien avec le risque que ces
adaptations n’entraînent des hausses de prix susceptibles de
faire fuir des clients.
Pour évaluer la demande pour les abonnements Locali, 2684
personnes – représentant un total de près de 7400
Genevois.e.s si l’on tient compte de leur foyer – ont rempli
un questionnaire. Bilan : un pourcentage important d’entre
elles seraient disposées à changer leurs habitudes de
consommation. L’alimentation arrive en tête avec 69% des
répondant.e.s prêt.e.s à souscrire un abonnement de 300
francs par mois pour bénéficier d’un accès à une nourriture
locale, saine et écologique.
Les abonnements à la bibliothèque d’objets, à une vêtithèque
et à un système de véhicules partagés ont rassemblé
respectivement 64, 56 et 54% de réponses favorables. Fort de
ces résultats encourageants, APRÈS-GE travaille à déployer
cette offre dans les deux quartiers étudiés et prévoit de
les étendre à trois autres quartiers en construction: Le
Rolliet à Plan-les-Ouates, Belle-Terre à Thônex et
Acacias-Quai des Vernets à Genève.
J.M.
Michael Balavoine
Le discours dominant est alarmiste sur l’état et la
durabilité du système de santé suisse. Commençons par
prendre le contrepied de cette toile de fond. Peut-on
vraiment dire que la Suisse est si mal lotie en matière
de santé ? Le système suisse ne dispose-t-il pas d’une
base solide pour faire face au futur ?

Laurent Kurth
C’est vrai que, malgré toutes les limites et les
lacunes qu’on lui connaît, le système de santé suisse
reste, en comparaison internationale, l’un des
meilleurs du monde. Il répond, pour l’instant encore
en grande partie, à trois promesses fondamentales de
la loi sur l’assurance maladie (LAMal) : une
solidarité entre jeunes et personnes âgées, une
solidarité entre malades et bien portants et une
solidarité dans l’accessibilité aux soins quel que
soit le niveau de revenu. On peut discuter du dernier
point, où des limites commencent à apparaître. Mais
disons que, globalement, nous avons encore en Suisse
un niveau de qualité et d’accessibilité aux soins qui
est plus que satisfaisant. Lorsqu’une personne
souffre, elle trouve des soignants, des médecins, des
hôpitaux et des structures de soins dans un périmètre
géographique relativement proche, avec une prise en
charge de qualité et une couverture financière
assurée. Pour faire court, celui qui sollicite des
soins y a accès au moment où il les sollicite sans
qu’il y ait trop de barrières en termes d’âge ou de
revenu. Ce sont ces valeurs de qualité,
d’accessibilité et de solidarité qu’il faut chercher à
préserver, voire à développer, dans le système de
soins du futur.
Ce sont ces valeurs de qualité, d’accessibilité et de solidarité qu’il faut chercher à préserver, voire à développer, dans le système de soins du futur.

Stéfanie Monod
Il faut aussi ajouter un point fondamental pour le
contexte suisse qui n’est pas lié directement au
système de santé : la population helvétique est en
bonne santé parce que nous avons un très bon niveau de
vie, un système éducatif performant et un
environnement favorable. Ce sont ces facteurs externes
qui font que la population suisse est en bonne santé.
En comparaison internationale, on part avec plus de
chances que les autres. Ce sont ces chances que nous
aimerions conserver pour le futur. Or, pour que cette
qualité de vie soit préservée, il ne faut pas investir
uniquement dans les soins comme nous le faisons
aujourd’hui. Il faut penser plus globalement aux
déterminants socio-économiques et environnementaux qui
sont cruciaux pour la santé des individus et des
populations.
M.B.
Comment expliquer que le système de santé suisse, comme
celui de tous les pays occidentaux, semble se fissurer
?
S.M.
Il y a eu, depuis les années
1950, un courant de forte spécialisation en médecine. On a
concentré les expertises, notamment dans les hôpitaux de
soins aigus. Aujourd’hui, nous avons des systèmes
hospitaliers industrialisés ultra-sophistiqués où, pour
soigner n’importe quelle pathologie, nous avons non
seulement besoin de plusieurs médecins, mais aussi de tout
un ensemble de soignants et autres professionnels.
Malheureusement, cette approche ne répond pas aux besoins
de soins les plus fréquents que sont les soins chroniques
et de longue durée. Pour assurer ce type de prise en
charge, il faut surtout des soins primaires forts, de la
coordination des soins et des communautés locales très
investies dans les problématiques de santé. C’est
exactement ce dont nous manquons, comme d’ailleurs
l’ensemble des pays qui nous entourent.
M.B.
Si tous les pays occidentaux sont confrontés au même
type de problème, n’existe-t-il pas une recette venant
d’un autre pays qui pourrait s’appliquer à la Suisse
?
S.M.
Non. Il importe de ne pas
tomber dans le piège de l’un qui fait mieux que l’autre.
L’histoire des systèmes de santé est tellement ancrée dans
la culture et l’histoire des pays que chacun doit trouver
son propre chemin. On le voit très bien : les États
fortement centralisés, comme la France, cherchent à
décentraliser au maximum. Ceux qui sont au contraire
fortement décentralisés essaient de rassembler des
compétences. À force de fusions, le Québec a construit une
gouvernance unique de tout son système de santé. Au
contraire, les Britanniques, qui finançaient entièrement
les soins par l’impôt, ont privatisé une partie du
système. Il n’y a pas de recette miracle. Partout, les
situations sont complexes et les chemins pour faire
évoluer les systèmes sont à inventer en partant des
contextes particuliers de chaque pays.
L.K.
En Suisse, nous avons observé
les mêmes types de mouvements qu’ailleurs. À Neuchâtel, au
début du XXIe siècle, les structures de soins ont été
cantonalisées. Il y a eu un fort mouvement de
concentration, avec la création d’un hôpital, d’une
organisation de soins à domicile et d’un centre de
psychiatrie. Le financement des EMS est aussi assuré par
le canton. Lorsque j’ai débuté au gouvernement il y a onze
ans, il n’y avait plus un seul dicastère de la santé dans
la cinquantaine de communes neuchâteloises. Aujourd’hui,
elles se réinvestissent dans des missions de proximité
comme l’organisation du tissu associatif, l’accompagnement
des aînés, l’aménagement de l’espace public ou la
prévention. Ce sont des tâches qui doivent être ancrées
dans la proximité et tenir compte de la diversité des
réalités locales. C’est d’ailleurs cette diversité des
situations qui fait également qu’il n’est pas possible, en
Suisse, d’imaginer une solution fédérale globale. Le
contexte est trop différent entre des cantons comme le
Valais et ceux de Genève ou Zurich.
M.B.
Dans le contexte des soins chroniques et de longue
durée, le fédéralisme suisse n’est-il pas une chance
?
L.K.
Oui. Globalement, nous avons
les qualités d’un pays riche à très forte densité urbaine.
Il y a des pôles rapprochés qui créent un maillage très
fin sur l’ensemble du territoire. Avec, en plus, une
structure fédéraliste qui fait que chacun assume les
responsabilités liées à la proximité.
S.M.
C’est vrai que cette dimension
territoriale, qu’elle soit cantonale ou communale, est une
chance magnifique pour la gestion de la santé des
populations et des problèmes de prise en charge qui
s’annoncent. Pour appréhender le vieillissement
démographique, les soins primaires, la prévention ou la
promotion de la santé, il y a un fort besoin de
régionalisation. Mais pour être efficace, il est cependant
nécessaire de repenser comment articuler l’ensemble de ces
échelons de régulation. Cela permettrait de rendre la
Suisse dynamique dans le domaine de l’organisation des
soins de demain.
La première question à régler, c’est cette distinction entre ce qui relève de l’assurance et ce qui relève de la gouvernance globale du système.
M.B.
Une partie du problème de gouvernance du système de
santé suisse est-elle donc liée à ce millefeuille
fédéraliste ?
L.K.
Nous avons effectivement, en
Suisse, un problème d’intrication de responsabilités
politiques que nous n’avons jamais affronté. D’un côté,
les cantons sont responsables de l’organisation du système
de santé sur leur territoire. Ils doivent fournir des
soins et organiser des politiques de santé publique. Comme
l’éducation, la sécurité ou la culture, la santé est, pour
une large part, une compétence cantonale. Les assurances
sociales relèvent en revanche de l’échelon fédéral. La
confrontation entre ces deux logiques n’a jamais été
réglée. Or, la LAMal est devenue très intrusive dans la
gestion du système de santé lui-même, ce qui limite
beaucoup la capacité d’action des cantons. Beaucoup de
gouvernements cantonaux se considèrent d’ailleurs comme de
simples organes d’exécution de la LAMal et oublient qu’ils
sont responsables du système de santé et de soins,
simplement parce qu’il y a déjà tellement à faire pour
répondre aux exigences de la loi fédérale qu’il ne reste
plus de temps, ni d’argent, ni parfois l’espace juridique
nécessaire pour élaborer et assumer une politique
cantonale. La première question à régler, selon moi, c’est
cette distinction entre ce qui relève de l’assurance et ce
qui relève de la gouvernance globale du système.
Pour ce qui est des médicaments et des ressources humaines, il s’agit de questions qu’il faut régler à un niveau international.
M.B.
Concrètement, quels domaines devraient être gérés par
l’échelon fédéral ?
L.K.
La question des médicaments,
celle des maladies transmissibles ou encore celle de la
formation des professionnels relèvent aujourd’hui de la
compétence de la Confédération. Il y a un certain nombre
d’éléments pour lesquels il faut bien reconnaître que nous
vivons sur un seul espace national. Pour le reste, la
Confédération devrait poser un minimum de standards très
globaux. En revanche, la mise en œuvre de ces standards,
avec les réalités régionales diversifiées que nous
connaissons, devrait être du ressort des cantons, avec une
responsabilité politique clairement assumée. Autrement
dit, un politique fait des choix bien précis au niveau
cantonal et, selon les résultats qu’il obtient, il est
réélu ou non.
S.M.
Il y a même certains points où
la politique de santé est une politique extérieure… Pour
ce qui est des médicaments et des ressources humaines, il
s’agit de questions qu’il faut régler à un niveau
international. Penser l’échelon cantonal comme un
micro-État paraît vraiment désuet.
M.B.
Comment pourrait-on améliorer ce problème de
gouvernance ?
L.K.
Avec un vrai ministre de la
santé. En Suisse, nous avons un ministère de gestion de la
LAMal, mais pas de véritable ministère de la santé. Le
Parlement réglemente tout via la LAMal, qui est une loi
d’assurance. Il s’immisce pourtant ainsi dans
l’organisation du système de soins, avec de multiples
contraintes nouvelles chaque année. Les exécutifs
cantonaux sont progressivement sortis du jeu sans que
l’exécutif fédéral puisse être saisi de nouvelles
prérogatives. Plus personne ne peut dès lors agir sur
l’organisation des politiques de santé et en assurer la
cohérence. C’est le cœur du problème de la gouvernance du
système suisse. Il faut réinstaurer des responsabilités
politiques pour avoir les moyens de mettre en place de
vraies politiques de santé publique. L’exemple de la
prévention et de la promotion de la santé est pour le coup
frappant. On a externalisé cette tâche à une fondation,
Promotion Santé Suisse. Il y a un pilotage
organisationnel, avec une redistribution de la manne dans
le territoire, mais aucune capacité d’influencer les
autres politiques qui ont des impacts importants sur la
santé. Cela serait pourtant la plus significative démarche
de prévention. Dans les exécutifs, on a tellement
intériorisé le fait que le système est régi par une
législation d’assurance (la LAMal) qu’il est difficile
pour les ministres de la santé d’obtenir un budget pour
mettre en place un vrai service public si l’exigence ne
découle pas directement de la LAMal. On peut le faire à la
marge, si on arrive à obtenir des résultats dans les deux
ans. Mais pour des actions de santé publique à plus long
terme, comme l’organisation des soins primaires, cela
devient pratiquement impossible. Et sans ce type d’action
politique, il n’est simplement pas possible de produire de
la santé.
Il faudrait que la santé fasse partie des délibérations lorsqu’on traite d’environnement ou d’alimentation, car ces éléments sont centraux pour la santé des populations.
M.B.
Un ministère de la santé permettrait aussi de mener des
politiques intersectorielles qui sont cruciales pour la
santé publique. Qu’en pensez-vous ?
S.M.
En effet, pour autant que la
Confédération ait des responsabilités en matière de santé
constitutionnelle. Dans le projet de révision de la loi
sur les épidémies, le législateur a ajouté 20 à 30 fois le
mot one health pour bien marquer cette
interdépendance de la santé humaine avec de nombreuses
autres politiques publiques. Mais il manque cet ancrage
constitutionnel qui puisse rendre l’État responsable de
défaillance dans le domaine large de la protection et de
la promotion de la santé. Ce manque de représentativité à
la fois juridique et politique au niveau fédéral est ce
qui empêche de pouvoir mener des politiques
intersectorielles qui sont tellement nécessaires
aujourd’hui pour produire de la santé. Il faudrait que la
santé fasse partie des délibérations lorsqu’on traite
d’environnement ou d’alimentation, car ces éléments sont
centraux pour la santé des populations. Aujourd’hui, il
est impossible d’intervenir parce qu’il n’y a pas de bases
juridiques et de moyens politiques pour ce type
d’interventions.
L.K.
Toutes ces questions
transversales de politiques publiques qui ont un impact
sur la santé sont effectivement évacuées du débat. Je
serais curieux de voir combien il y a de co-rapports qui
sont établis lorsque le Conseil fédéral parle de travail,
de sécurité ou d’environnement. Probablement très peu.
C’est pourtant ce qui se pratique pour l’énergie,
l’aménagement du territoire ou les finances. Il n’y a plus
de politiques sectorielles qui se déploient sans que les
impacts qu’elles ont sur ces domaines soient examinés.
Sauf pour la santé publique, qui échappe complètement à
cette logique.
Le risque, c’est vrai, avec la concentration est de se déconnecter des réalités et de la diversité des régions.
M.B.
C’est pour remettre de l’ordre dans ces responsabilités
politiques que vous proposez, l’un et l’autre
d’ailleurs, une loi de santé ?
L.K.
À l’origine, l’idée d’une loi
était de remettre un peu d’ordre dans un ensemble de
compétences aujourd’hui mal définies. Mais cette idée a
été mal comprise. On se frotte très rapidement à des
problèmes de défense du fédéralisme avec ce genre de
question. Si on résume grossièrement, l’architecture
constitutionnelle de la Suisse, ce sont 22 puis 26 cantons
qui se mettent ensemble et qui décident de remonter
certaines compétences au niveau fédéral. Tout ce qui n’a
pas été explicitement délégué vers le haut reste cantonal.
Alors, quand vous proposez de centraliser un peu plus,
vous avez tous les fédéralistes qui se réveillent et vous
disent que vous allez affaiblir la qualité du pays et
introduire un excès de centralisation. On vous dit : «
Attention, vous allez perdre la proximité du terrain,
l’autonomie et la saine émulation liée à la concurrence
entre cantons. » Ce que je ne conteste pas d’ailleurs. Le
risque, c’est vrai, avec la concentration est de se
déconnecter des réalités et de la diversité des régions.
Il faut donc une loi de santé, mais qui soit minimale, qui
pose quelques grands principes et quelques grands
standards et fixe de façon exhaustive les compétences de
la Confédération, mais dont l’essentiel de l’exécution
reste cantonal. Et, surtout, une législation qui clarifie
les responsabilités : ce qui est laissé à l’initiative des
cantons n’est pas régi par une autre loi, en l’occurrence
celle sur l’assurance maladie.
 S.M.
S.M.
Une loi fédérale permettrait
surtout de forcer la réalisation d’une vraie stratégie
commune entre Confédération et cantons en faveur de la
santé et du système de santé. À l’heure où les défis sont
massifs, il faut poser des principes qui garantissent les
valeurs fondamentales que sont la protection de la santé,
l’accès équitable aux soins de qualité ou encore la
sécurité financière. Les questions de financement, de
planification des ressources en professionnels ou en
matériel, de même que l’organisation des services à
différents niveaux devraient aussi être clarifiées dans
une telle loi.
👉Lire l’étude « Analyse de la gouvernance du système de santé suisse et proposition d’une loi fédérale sur la santé »
M.B.
Contrairement aux idées reçues, une loi de santé
pourrait-elle redonner du pouvoir d’agir aux cantons
?
L.K.
Probablement. Il faut bien se
rendre compte qu’aujourd’hui il y a des dizaines de
millions de francs qui sont dépensés sur injonction
fédérale liée à la LAMal. Les frais d’hébergement en EMS,
la participation hospitalière, les subsides pour
l’assurance maladie : ce sont des paquets d’argent qui
représentent la majorité des budgets cantonaux de la santé
et qui sont imposés par le droit fédéral. L’idée n’est
donc pas de donner encore plus de prérogatives à cet
échelon. Il s’agit de mettre de l’ordre dans cette
multitude de normes qui créent des obligations pour les
cantons tout en affaiblissant leur capacité à mener une
vraie politique de santé. Le projet, ce n’est pas de
centraliser plus. On veut simplement mettre de l’ordre
dans les compétences des uns et des autres.
En Suisse, on se vante de notre démocratie directe. Mais, pour la santé, les choix ne sont pas du tout démocratiques.
M.B.
La question de la gouvernance du système ne règle
toutefois pas une préoccupation légitime du politique et
de la population : celle des coûts. Comment améliorer
l’acceptabilité financière des prestations ?
L.K.
Il faut d’abord relever qu’il
y a un énorme gaspillage dans le système actuel. La
compétition conduit, comme toujours quand elle s’effectue
autour de financements publics sans limite budgétaire, à
une forme de « course à l’armement ». Avec la LAMal, il
n’y a pas de contraintes budgétaires ou politiques.
Lorsqu’on passe la porte d’un hôpital, on sait que la
prestation va être payée. La prestation appelle ainsi le
financement, ce qui aboutit à une débauche de moyens. Avec
une rémunération à l’acte, l’offre de prestations se
développe dans les secteurs les plus rentables plutôt que
selon des indications de santé publique.
S.M.
J’ajouterais, pour faire le
lien avec la gouvernance du système, que le problème avec
cette débauche de moyens et cette course à la prestation,
c’est qu’il y a une absence totale d’arbitrage. Ces
montants sont alloués automatiquement en fonction de
l’activité. Mais est-ce bien là qu’on en a le plus besoin?
Que fait-on des 3 à 4 milliards de francs supplémentaires
que nous allouons chaque année ? En Suisse, on se vante de
notre démocratie directe. Mais, pour la santé, les choix
ne sont pas du tout démocratiques. Il n’y a ni référendum
possible, ni budget voté. Au regard du montant des
dépenses, c’est quand même ahurissant.
M.B.
Ce constat du problème d’incitatifs à en faire plus et
d’absence de contraintes est largement partagé. Mais
comment le juguler ?
L.K.
Cela peut paraître
iconoclaste, mais je pense que restaurer un service public
peut être une partie de la solution. Aujourd’hui, une
autorité cantonale ne peut plus organiser une offre de
base, un socle, qui veut que les patients aient un accès
en un temps raisonnable à une prise en charge de première
ligne, à une policlinique et à un centre hospitalier. On
ne peut pas non plus établir des logiques d’éducation à la
santé, de prévention, de promotion ou de suivi des
maladies chroniques avec des incitatifs de santé publique.
Il n’y a que le financement à la prestation qui est
remboursé. Avec cet aspect pervers que les prestataires de
soins ont comme « intérêt » à ce que la population soit en
mauvaise santé pour qu’elle consomme du soin remboursé.
On gagne en réalisant un acte, mais plus on en réalise, plus la marge s’accroît. C’est un système inflationniste qui pousse à la surconsommation.
M.B.
On va vous accuser de vouloir étatiser la
médecine…
L.K.
Comprenez-moi bien, je ne suis
pas contre une partie de financement à la prestation. Mais
il y a aujourd’hui un véritable effet pervers de la
prestation. Nous avons un tarif qui couvre le coût complet
dès la première unité, y compris les coûts fixes. Le prix
reste identique si on double la quantité. Ce qui amène à
une situation extraordinaire: on gagne en réalisant un
acte, mais plus on en réalise, plus la marge s’accroît.
C’est un système inflationniste qui pousse à la
surconsommation, alors même que nous entrons dans une ère
de pénuries en termes de soignants et d’argent. Plus j’en
fais et plus je gagne. Le trop devient le plus
rémunérateur. Avec un socle de base de santé publique, on
pourrait corriger le tir. Un service de base qui serait
financé par d’autres moyens que l’assurance. Et,
là-dessus, on ajoute une offre liée à la prestation, mais
qui ne couvre pas le coût complet. Ce qui fait qu’il faut
atteindre des tailles critiques pour être rentable. Avec
un tel système, une offre pléthorique ou sous- optimale ne
fonctionnerait pas. Rétablir un service public est donc
aussi une question d’efficience économique.
M. B.
Le financement du système va devenir encore plus
problématique avec le vieillissement de la population.
Comment intégrez-vous cet élément dans vos
réflexions.
L.K.
C’est un autre chapitre
inquiétant. Si on double la population des personnes de 85
ans et plus, on double le nombre de gens qui représentent
les trois quarts des coûts de la santé aujourd’hui. On
peut faire la chasse au gaspillage un moment, mais ça ne
suffira pas. Le financement ne peut pas s’appuyer sur les
dispositifs actuels, qui vont faire exploser les budgets
des ménages. Il faut que la Confédération et les cantons
s’entendent pour trouver un financement public des
prestations au quatrième âge, au moins sur une génération.
Mais il y a tout de même une bonne nouvelle là-dedans : la
courbe démographique du quatrième âge va fortement
augmenter avec les baby-boomers, puis va redescendre. On
est donc sur une problématique de financement d’une
génération.
S.M.
Sauf erreur, en 2019, on était
à quatre ou cinq actifs pour une personne de 65 ans et
plus. En 2050, ce ratio sera de deux pour un et, dans
certains cantons, le rapport total de dépendance sera
proche d’un pour un si l’on considère à la fois les 65 ans
et plus et les moins de 20 ans. L’impact sur le
financement des politiques publiques, y compris dans les
domaines de la santé et du social, sera majeur. Même sur
une génération, les choix sur les investissements à faire
vont être drastiques. Comment se prépare-t-on à cet
arbitrage? Il n’y a rien aujourd’hui pour thématiser cette
question dans le débat public.
La logique actuelle a transformé les actes médicaux et les institutions en centres de profit.
M.B
La question des pénuries de soignant.e.s complique
encore l’équation à résoudre pour le système de santé.
Sur ce sujet, une meilleure gouvernance peut-elle aussi
apporter des solutions.
L.K.
Je dirais assez simplement que
ce que nous n’avons pas voulu régler politiquement et
financièrement, en pensant qu’un pays riche comme le nôtre
pouvait tout se payer, va finir par s’imposer à nous. À
force de ne pas vouloir mettre de limites, c’est la
finitude du monde dans lequel nous vivons qui va
s’imposer. On peut penser que ça sera l’environnement, je
pense que ce seront les ressources humaines avant. Avec un
drame: plutôt que de gérer des priorités, il va falloir
gérer la pénurie. Et ça, globalement, ce n’est pas sain.
Poussé à l’extrême, cela veut dire que, pour bénéficier de
soins, il faudra être le plus riche, le plus fort ou l’ami
du puissant. C’est un peu un désastre politique que de ne
pas reconnaître que nous sommes face à une rareté de
ressources économiques, humaines, énergétiques et même
peut-être techniques et qu’il faut, pour y faire face,
définir des priorités. Pour moi, c’est normalement le rôle
du politique que de définir ces priorités. Pour l’instant,
nous n’y sommes pas arrivés.
S.M.
Il est clair qu’il va manquer
d’importantes ressources, notamment au détriment des soins
de longue durée, si on ne pense pas le système autrement.
Il manque effectivement une capacité d’anticipation et un
débat autour des allocations de ressources et des
priorités du système. La logique actuelle a transformé les
actes médicaux et les institutions en centres de profit,
avec des systèmes industriels hyper spécialisés qui
consomment énormément de ressources humaines pour un
résultat en termes de santé populationnelle qui est
marginal. Le problème, c’est que des grosses machineries
comme les hôpitaux sont difficiles à réformer, tant les
processus et les trajectoires de soins deviennent
illisibles. Il y a pourtant un moment où il faudra
effectuer des choix, en faveur d’un investissement dans la
communauté. Et plus ceux-ci seront tardifs, plus ils
seront difficiles.
Le temps passé par le soignant auprès du patient est devenu marginal. […] Et celui passé à alimenter les données dans le système de facturation et d’information a pris le dessus. […] Pour moi, c’est le signe d’un système malade, c’est un système qui panique.
M.B
Cette logique de production de soins conduit en plus à
une grande souffrance du côté des soignant.e.s…
L.K.
La logique actuelle crée un
cercle vicieux très insatisfaisant pour les
professionnels. Sur une journée de huit heures, le temps
passé par le soignant auprès du patient, c’est-à-dire ce
pour quoi il a été formé et engagé et ce dont la société a
le plus besoin, est devenu marginal. Parce que ce qu’on
demande aujourd’hui en termes de monitoring du système est
devenu démentiel. Le temps passé à alimenter les données
dans le système de facturation et d’information a pris le
dessus. D’un point de vue politique, quand on voit le peu
de données auxquelles on a accès, on se demande bien
pourquoi les soignants passent autant d’heures à nourrir
la machine. Pour moi, c’est le signe d’un système malade,
c’est un système qui panique. Lorsque cela arrive, on
multiplie les besoins de justification et de monitoring.
Ce qui épuise et démotive les gens et ce qui accélère
finalement la pénurie.
S.M.
Oui, on peut penser que
maintenir le système a plus de valeur que ce qu’il
produit. Et que la résultante est une déshumanisation tant
des professionnels que des patients.
M.B.
Le tableau que vous dépeignez n’est-il pas un peu
sombre ?
L.K.
Je ne le crois pas. Je pense
que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de
voir des bouts du système qui vont réellement s’effondrer.
Avec des effets collatéraux : une génération sacrifiée et
une forme d’anarchie dans l’offre de soins. Je pense aussi
qu’il faut des organes où se crée le débat éthique pour
asseoir ensuite les choix politiques de santé publique et
pour définir les priorités et l’allocation de ressources.
Sinon, les choix seront forcément démagogiques.
L’alternative à cette démarche, c’est l’anarchie et la loi
du plus fort.
S.M.
Les jeunes à qui j’enseigne
ces sujets sont de plus en plus nombreux à dire qu’il faut
que ces systèmes s’effondrent pour pouvoir plus rapidement
reconstruire quelque chose qui ait du sens. Mais il s’agit
d’une déconstruction majeure et très complexe. C’est pour
cette raison que je pense vraiment qu’il faut une place
pour un débat sur ces questions et ces enjeux. Il faut
construire des narratifs alternatifs pour construire un
autre système. Pour moi, ces débats sont des opportunités
extraordinaires de refaire société autour de questions
fondamentales.
M.B.
Rester inactif n’est, pour vous, pas une option. Agir
est toutefois compliqué, tant les intérêts des
différents lobbys dans le domaine sont tout à la fois
divergents et puissants. Quelles sont vos pistes pour
initier une mutation du système ?
L.K.
Près de 90 milliards de francs
de dépenses, vous vous rendez compte de ce que cela
représente comme intérêts financiers ?! Un franc sur huit
de la richesse produite chaque année dans le pays va dans
le système de santé. C’est dire les intérêts qu’il y a
là-derrière. Et ce ne sont pas de petits acteurs : les
pharmas, les cliniques privées et les assureurs
S.M.
N’oublions pas qu’on leur a
laissé toute la place. Il est temps de réveiller la
responsabilité sociale de la Confédération et des cantons
et de défendre une vision plus ambitieuse, et surtout
d’anticiper. Gouverner, c’est prévoir, non ?
M.B.
Il n’y a que les citoyen.ne.s et les patient.e.s qui ne
soient pas représenté.e.s…
L.K.
Oui, ce sont les grands
absents des débats. Il serait pourtant simple d’instaurer
un financement pour les associations de patients comme on
le fait pour les consommateurs, afin que ces structures ne
soient pas moribondes comme aujourd’hui et puissent
participer au débat autour des grands enjeux de société.
M.B.
Autrement dit, impossible de faire évoluer le système
sans prendre en compte sa situation actuelle notamment
ses acteur.trice.s et lobbys, son fédéralisme et son
faible ancrage dans des débats ?
L.K.
C’est ma conviction. Il y a un
modèle idéal. Mais il y a surtout un modèle pragmatique
sur lequel on est concrètement capable d’avancer. Pour
moi, il faut travailler sur ce que j’appelle des verrous.
Le verrou fédéral, le verrou du financement, le verrou du
débat. Il me semble qu’il faut y aller par petits pas et
par étapes, en gardant les acteurs actuels dans le jeu,
sinon on perd à tous les coups. Je ne suis pas favorable,
par exemple, au lancement d’une énième votation sur la
caisse unique, qui vise à sortir les assureurs du jeu et
qui va nous faire perdre du temps. En revanche, proposer
un financement public pour le quatrième âge et que
l’assurance actuelle continue à s’occuper du reste, cela
me semble une excellente première étape. On peut ensuite
envisager le progrès suivant. Il s’agit d’être
pragmatique, et peut-être un peu opportuniste, sinon nous
n’avons aucune chance de faire bouger les lignes.
Notes
Une loi fédérale sur la santé: oui, mais à quelles conditions?
En février 2024, un rapport sur la faisabilité et la
pertinence d’une loi fédérale sur la santé a été publié
par Unisanté. L’étude,
disponible en ligne, a été dirigée par Stéfanie Monod et financée par
l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Elle a
permis à l’équipe de recherche d’analyser le cadre
juridique encadrant la gouvernance du système de santé
suisse, d’en analyser la performance et de déterminer le
contenu que pourrait prendre une loi fédérale sur la
santé.
Consciente de l’enjeu sociétal lié aux questions autour du
système de santé, notamment au travers des discussions
suscitées par l’initiative Santé intégrative & société
(santeintegrative.ch), la Fondation Leenaards a accompagné
ce processus en finançant deux workshops. Le premier,
scientifique, a rassemblé des chercheur.euse.s de
plusieurs disciplines autour des enjeux de gouvernance du
système de santé. Le second a réuni de nombreuses parties
prenantes du système (directeur.trice.s généraux.ales de
la santé, personnalités politiques, faîtières, etc.) pour
discuter et échanger autour des objectifs que pourrait
avoir une loi fédérale sur la santé. En mai 2024, l’ASSM a publié une prise de position en faveur d’une
telle loi.
Portraits : © DR

Diffusée par l’ASSM le 23 mai 2024
 Pour lire l’étude « Analyse de la gouvernance du
système de santé suisse et proposition d’une loi
fédérale sur la santé »
Pour lire l’étude « Analyse de la gouvernance du
système de santé suisse et proposition d’une loi
fédérale sur la santé »
de Monod S., Pin S., Levy M., Grandchamp C., Mariétan
X., Courvoisier N.
Lausanne, Unisanté – Centre universitaire de médecine générale et santé publique, 2024 (Raisons de santé 354)

Pour lire l’article
« Système de santé suisse : y a-t-il un pilote
dans la machine ? »
De Stéfanie Monod, Virginie Cavalli, Stéphanie Pin
et Chantal Grandchamp
Paru dans la Revue médicale suisse, numéro 819/mars 2023

Pour lire l’article « Système de santé suisse : une machine boulimique »
De Chantal Grandchamp et Stéfanie Monod
Paru dans la Revue médicale suisse, numéro 867/mars 2024
Lire l’interview de Laurent Kurth par Alexandre Steiner « Étatiser davantage la santé? La proposition qui divise fortement » paru dans Le Temps du 06.02.2023